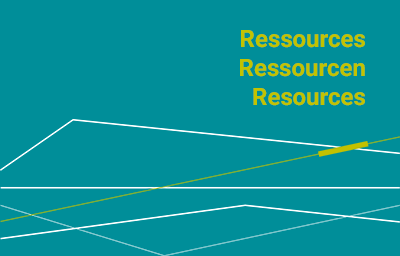Policy Paper Vol. 7

Les étroites relations et interdépendances transfrontalières qui se sont tissées dans la région frontalière SaarLorLux sont liées de manière déterminante au processus d’intégration européenne. Parallèlement, il apparaît, d’une part, que la coopération transfrontalière nécessite d’un nouvel élan pour de plus amples approfondissements et, d’autre part, qu’elle peut être contrecarrée et entravée par des aspirations nationalistes et populistes. Sur la base d’enquêtes quantitatives et qualitatives menées auprès de décideurs communaux de la Sarre (Allemagne), du département de la Moselle (France) et du Grand-Duché de Luxembourg en 2024, le Policy Paper identifie six domaines d’actions centrales assorties de recommandations politiques. Il est nécessaire (1) d’accélérer les efforts existants dans les domaines de l’éducation et des langues, (2) de réduire les obstacles bureaucratiques, (3) de renforcer les compétences communales, (4) de se rapprocher des citoyens et (5) de mettre en place des procédures pragmatiques. L’objectif global est (6) de faciliter la coopération transfrontalière dans tous les domaines. L’Europe, et plus concrètement l’UE, sont synonymes d’une cohabitation qui peut être vécue par-delà les frontières, non pas comme une évidence qui va de soi, mais plutôt comme une perspective qui nécessite un grand engagement sans relâche et des possibilités appropriées.